Avec 10 186 624 km², la France jouit du deuxième espace maritime du monde, après les États-Unis (11 351 000 km²) et avant l’Australie (9 025 053) puis la Russie (7 566 673), en additionnant notre mer territoriale et nos 9,63 millions de km² de zone économique exclusive (ZEE). Selon le géographe Jean-Benoît Bouron de l’École normale supérieure de Lyon, « une ZEE est un espace maritime ou océanique situé entre les eaux sous souveraineté (majoritairement constituées de la mer territoriale) et la haute mer, sur laquelle un État riverain (parfois plusieurs) dispose de l’exclusivité d’exploitation des ressources ».
Cette surface, calculée par le Service hydrographique et océanographique de la Marine nationale (SHOM) en vertu de la Convention des Nations unies de Montego Bay (1982), est porteuse de nombreux enjeux géopolitiques, d’autant qu’elle n’est pas toujours en corrélation avec le plateau terrestre de chaque État : ainsi, la France possède une ZEE comparable à celles des États-Unis et de l’Australie alors que son plateau est trois fois plus petit, et même cinq fois par rapport à la Russie.
Pour décrypter ces enjeux, l’IHEDN a interrogé Virginie Saliou, docteure en science politique, capitaine de frégate de réserve et chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), spécialisée dans les enjeux de gouvernance maritime, de maritimisation du monde et de sécurisation des espaces maritimes, ainsi que le vice-amiral d’escadre (en 2e section) Jean Hausermann, chef de la majeure Enjeux et stratégies maritimes de la session nationale de l’IHEDN et, notamment, ancien commandant supérieur des forces armées aux Antilles et commandant de la zone maritime. Entretien croisé.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS DE SÉCURISATION ET DE DÉFENSE LIÉS À L’IMMENSITÉ DE LA ZEE FRANÇAISE ?
Virginie Saliou : Conformément au droit établi par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNDUM) de Montego Bay en 1982, que la France a ratifiée en 1996, notre pays dispose de droits souverains et de juridiction dans un espace nommé zone économique exclusive (ZEE). Très concrètement, ces droits portent principalement sur l’exploitation et la protection des ressources de la colonne d’eau, du sol et du sous-sol marin dans une limite de 200 milles nautiques depuis la ligne de base. La France compte ainsi 9,63 millions de km² de zone économique exclusive sur ses 10,9 millions de km² d’espaces maritimes (élargissement du plateau continental inclus).
La sécurisation de la ZEE française consiste dès lors à protéger ces ressources des pillages et prélèvements illégaux, que ce soit dans le domaine halieutique comme dans le domaine des ressources génétiques marines ou celui des minerais critiques. La protection des ressources est ici prise dans un sens élargi puisque l’État côtier dispose de droits, par exemple, pour lutter contre les navires pollueurs qui viendraient impacter l’environnement marin. L’État côtier est également souverain dans le domaine de la recherche et prévient pour cela les campagnes océanographiques illégales dans ses eaux. Défendre sa ZEE revient donc à en protéger les ressources, en luttant contre les activités illégales et en préservant leur potentiel stratégique par une gestion raisonnée du milieu marin.
Jean Hausermann : La France possède la deuxième plus grande ZEE au monde, répartie sur tous les océans grâce à ses territoires d’outre-mer. Cette immensité maritime représente un atout stratégique majeur, mais également un défi colossal en matière de sécurité et de défense. Le premier défi de la sécurisation de la ZEE française est celui de sa grande dispersion géographique, car ses espaces sont présents sur presque tous les océans du globe. Ils sont menacés, d’une part, par les activités criminelles – principalement la pêche illégale et les trafics illicites (stupéfiants, armes, êtres humains) –, et d’autre part, par des pressions géopolitiques, notamment dans le Pacifique avec la montée en puissance de la Chine ou par des contestations de souveraineté comme celle de Madagascar pour les îles Éparses.
Enfin, les enjeux environnementaux sont importants sur des écosystèmes fragiles et une biodiversité exceptionnelle dans des zones souvent vulnérables. Pour relever les défis de la sécularisation de sa ZEE, la France mise sur sa présence militaire, un effort important de surveillance et sur des coopérations régionales.
CONCRÈTEMENT, COMMENT S’EFFECTUE L’ADÉQUATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS RÉGALIENS (MARINE NATIONALE, DOUANES, GENDARMERIE MARITIME…) ?
Jean Hausermann : La coordination entre les différents acteurs régaliens en outre-mer repose sur la structure de l’Action de l’État en Mer (AEM), adaptée aux spécificités ultramarines. Il s’agit d’une coordination interministérielle pilotée par le délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDG AEM – équivalent du préfet maritime en métropole) assisté par un officier de marine, le commandant de zone maritime. Le DDG AEM est chargé d’animer et de synchroniser les interventions des différents services disposant de moyens maritimes et aériens : Marine nationale, douanes, gendarmerie maritime, affaires maritimes, etc.
Cette coordination vise à garantir la souveraineté, la sécurité, la protection de l’environnement, et la lutte contre les trafics illicites. Si chaque administration a son cœur de métier, toutes contribuent à l’ensemble des missions de l’AEM. Cette polyvalence assure ainsi une efficience maximum alors que les moyens outre-mer sont comptés.
Virginie Saliou : Pour intervenir en mer, la France dispose d’un modèle original et efficace, celui de l’AEM. La France n’a donc pas de corps de garde-côtes mais une « fonction garde-côte ». Ce dispositif vise à pouvoir utiliser et coordonner l’ensemble des moyens de toutes les administrations agissant en mer, par une autorité maritime unique – le Préfet maritime.
Toutefois, la principale administration disposant de moyens hauturiers pour agir dans les ZEE est la Marine nationale. Cette dernière est duale, c’est-à-dire capable d’intervenir autant pour des missions civiles que pour des missions militaires ou de défense en mer. Cette capacité est d’autant plus pertinente que l’État doit agir dans ce que l’on appelle un continuum sécuritaire, risques et menaces étant de plus en plus liés : des narcotrafiquants en mer ou des pêcheurs illégaux sont susceptibles d’ouvrir le feu, un accident de navigation peut dissimuler une attaque terroriste par voie de mer… La réponse de l’État français est donc pragmatique, alliant souplesse dans l’usage des moyens et rapidité de la chaine de commandement.
COMMENT LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER, QUI CONSTITUENT LA QUASI-TOTALITÉ DE LA ZEE FRANÇAISE, INFLUENCENT-ILS LA STRATÉGIE DE DÉFENSE NATIONALE ?
Virginie Saliou : La France a établi en 2015, puis révisé en 2019, sa stratégie de sécurisation des espaces maritimes. Ce texte élaboré par les services du Premier ministre avec l’ensemble des ministères concernés s’intéresse tout particulièrement aux outre-mer : 97% des espaces maritimes français sont en effet ultramarins. De ce fait, nous sommes voisins par la mer d’une trentaine d’États dans le monde.
Ces territoires sont des atouts considérables mais aussi des espaces de plus en plus vulnérables dans la mesure où, extrêmement étendus et souvent éloignés de la métropole et les uns des autres, leurs eaux et leurs ressources sont convoitées par des puissances étrangères et la criminalité organisée. Les menaces y sont variées : montée des eaux, immigration clandestine, pillages, narcotrafics…. Des forces de souveraineté françaises, dispositifs interarmées, sont déployées dans les outre-mer. La France, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, y a récemment renforcé ses moyens d’intervention et de surveillance.
La dernière Revue nationale stratégique actualisée en 2025 rappelle qu’une attention particulière doit être portée à ces territoires pour leur propre sécurité et celle de l’hexagone. Toutefois, l’ensemble des menaces auxquelles ils sont confrontés nécessite une réponse et des moyens encore aujourd’hui souvent insuffisants. De surcroît, les territoires ultramarins sont conduits à jouer un rôle croissant dans les décennies à venir dans le domaine de la défense : 90% de ces espaces sont situés en Indopacifique, dans une zone où se cristallisent les tensions militaires.
Parallèlement, les attaques sur les détroits, comme en mer Rouge, ont amené les flottes commerciales à emprunter des routes de haute mer où les îles, à l’instar de La Réunion, constituent désormais des points d’appui stratégiques. Dans ce contexte, les territoires ultramarins français sont autant des zones de projections potentielles pour les Armées que des espaces stratégiques à défendre et à protéger.
Jean Hausermann : Dans un monde marqué par la montée des tensions (face-à-face sino-américain en Indopacifique, ingérences étrangères, criminalité transnationale, compétition pour les ressources naturelles), les territoires ultramarins sont des vigies avancées pour la France. Ils lui permettent d’être partie prenante et riveraine de tous les océans du globe. Les outre-mer constituent ainsi des moyens uniques de comprendre les spécificités des régions dans lesquels ils sont implantés. La stratégie de défense française prévoit d’ici 2030 :
- Le renforcement des effectifs militaires en outre-mer (près de 1 000 soldats supplémentaires),
- La modernisation des équipements et des capacités de commandement,
- La sécurisation des approvisionnements en cas de conflit ou de rupture logistique, afin d’améliorer la résilience de nos outre-mer.
La présence militaire française dans les outre-mer permet enfin de raccourcir les délais d’intervention sur presque toute la surface du globe.
DANS LE CONTEXTE DE LA CONCURRENCE INTERNATIONALE POUR L’EXPLOITATION DES RESSOURCES MARITIMES, COMMENT LA FRANCE PROTÈGE-T-ELLE SES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX AU SEIN DE SA ZEE ?
Jean Hausermann : Les réponses stratégiques de la France face à la concurrence internationale pour l’exploitation des ressources maritimes se traduisent par une présence navale permanente constituée de patrouilleurs et de frégates de surveillance. Elle est régulièrement renforcée par des déploiements d’avions de surveillance maritime, de grands bâtiments amphibies, de frégates de premier rang, voire de sous-marins nucléaires d’attaque. Occasionnellement, le groupe aéronaval et son porte-avions se déploient dans la ZEE outre-mer pour assurer une forte présence dissuasive. Ces déploiements, qu’ils soient permanents, réguliers ou occasionnels, sont soutenus par un réseau de bases navales dans tous les DROM-COM.
Cette stratégie de présence militaire est renforcée par une stratégie de coopérations régionales. Elles peuvent prendre la forme de partenariats avec des pays voisins ou des organisations régionales comme l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est : Australie, Inde, etc.) pour des patrouilles conjointes et des exercices militaires. On peut également citer les patrouilles partagées avec l’Afrique du Sud pour les Terres Australes ou la participation active aux forums multilatéraux pour promouvoir la sécurité maritime.
Enfin, la France renforce ses capacités de surveillance maritime par le déploiement de satellites, de drones et de radars côtiers.
Virginie Saliou : La France s’appuie sur le droit pour défendre ses intérêts. D’abord en rappelant régulièrement les principes de la CNUDM auprès de ses partenaires internationaux. Ensuite en appliquant et faisant respecter ce droit en mer.
Malgré l’éloignement par exemple, la Marine française a intercepté, en 2013, un navire singapourien en pleine prospection pétrolière sans aucune autorisation dans la ZEE française autour des îles Éparses. Parallèlement, l’État a entamé une politique de protection du milieu marin, dépassant les objectifs mondiaux d’établissement d’aires marines protégées pour atteindre 24% d’espaces maritimes protégés en 2025.
Enfin, la France promeut un discours de limitation de l’exploitation des ressources marines, visible par exemple dans sa politique de lutte contre la pêche illégale, notamment aux côtés de ses partenaires africains, ou plus récemment en se positionnant en faveur d’une interdiction de l’exploitation des ressources minérales des fonds marins.
FACE À DE NOUVELLES MENACES, COMME LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA MONTÉE DES TENSIONS RÉGIONALES, QUELLES ÉVOLUTIONS DE LA DOCTRINE DE DÉFENSE DE LA ZEE SONT-ELLES ENVISAGÉES OU NÉCESSAIRES ?
Virginie Saliou : Un renforcement des moyens d’action en mer est indispensable afin de mieux protéger nos espaces maritimes. Il passe par des investissements dans de nouveaux navires bien sûr, mais également dans des drones et dans une capacité à surveiller depuis l’espace. Ces moyens doivent évidemment être complémentaires.
Toutefois, aucun État ne peut agir seul en mer. La clef réside dans le fait de penser la mer pour cet espace autre qu’elle est, et non de projeter des logiques terrestres en mer. La mer n’est pas un espace clos, elle reste un espace de passage, pour les poissons comme pour les hommes. La coopération y est donc primordiale – pour à la fois préserver les ressources et continuer à défendre la liberté de navigation – avec nos partenaires internationaux comme avec le secteur privé.
En parallèle, une maritimisation de notre défense, en s’appuyant sur ces atouts stratégiques que constituent nos territoires ultramarins, paraît un tournant, aujourd’hui, inévitable.
Jean Hausermann : La France relève donc le défi de la protection de sa ZEE en combinant présence militaire, coopération internationale, innovation technologique et diplomatie active. C’est une stratégie à la fois défensive et proactive, qui vise à préserver ses intérêts tout en contribuant à la stabilité globale.
Elle a choisi de renforcer sa présence militaire à la fois en nombre et en qualité pour faire face à l’augmentation des tensions internationales et de l’ampleur des catastrophes naturelles, principalement les cyclones. Le changement climatique se traduit en effet par des phénomènes cycloniques plus violents et plus fréquents.
Elle renforce également la résilience des outre-mer par des travaux d’infrastructures nouvelles de stockage et de stationnement des forces. La doctrine, elle, évolue dans le sens d’un plus grand appui mutuel des territoires ultramarins entre eux.
Source: Communication IHEDN

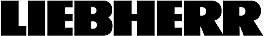






Be the first to comment on "ZEE française : comment sécuriser l’immensité ?"