« New space » : les défis stratégiques de la privatisation de l’espace
Porté par l’essor des acteurs privés et l’innovation technologique, le new space bouleverse les rapports de force dans l’espace. Entre ambitions de souveraineté, compétitivité industrielle et encadrement juridique encore fragile, la France et l’Europe cherchent leur place dans ce nouvel ordre orbital.
Au-dessus de nos têtes, une révolution silencieuse est en marche. L’époque où l’espace n’était accessible qu’aux grandes puissances – États-Unis, URSS puis Russie, Europe ou Chine – semble révolue. Depuis la fin des années 2000, un nouveau modèle s’impose : le new space. Ce terme, popularisé dans les années 2010, désigne la profonde transformation du secteur spatial sous l’impulsion d’acteurs privés. Également appelé « espace 2.0 », il incarne une nouvelle ère plus ouverte, plus compétitive, et résolument tournée vers les logiques de marché. « Le new space est un mouvement qui a véritablement pris de l’ampleur depuis une vingtaine d’années, notamment avec la création de SpaceX en 2002 », souligne la capitaine Béatrice Hainaut, chercheure sur les questions spatiales à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire.
Contrairement à la course spatiale de la guerre froide, pilotée par des États aux objectifs essentiellement idéologique ou militaires, ce nouveau modèle mise sur la rentabilité, la flexibilité et la réutilisation. Satellites miniaturisés, lanceurs récupérables, production industrielle accélérée : le new space redéfinit les règles du jeu.
L’accès à l’espace s’est d’ailleurs largement démocratisé avec l’irruption d’acteurs privés comme SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic. Aujourd’hui, plus de 1 000 entreprises du secteur spatial sont implantées aux États-Unis. En France, l’écosystème émerge avec des start-up innovantes telles que Latitude, HyPrSpace, Sirius Space Services, Opus Aerospace ou MaiaSpace.
L’espace était, pendant la guerre froide, un terrain de domination stratégique pour les superpuissances. L’effondrement de l’URSS en 1991 a ouvert la voie à une réorientation des capacités spatiales. « Les États-Unis ont vu dans le spatial une opportunité de prolonger leur domination stratégique au-delà de la guerre froide, en transformant leur avance technologique en avantage économique », affirme Béatrice Hainaut. L’avènement en 1998 de la Station Spatiale Internationale (SSI) a marqué un tournant géopolitique, privilégiant la coopération internationale sur la rivalité.
UN MOTEUR ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE
Le secteur spatial s’est progressivement transformé en un moteur économique stratégique. Libérés de la menace d’un rival idéologique, les États-Unis ont réorienté leur approche de l’espace pour en faire une ressource au service de leurs intérêts économiques. Des décisions clés prises sous l’administration Bill Clinton, telles que la libéralisation des satellites commerciaux à haute résolution en 1994 et la mise à disposition du GPS en 1996, ont ouvert la voie à la concurrence privée dans l’espace, transformant ce secteur en un domaine accessible aux acteurs privés.
« Ce phénomène a été amorcé dès la fin de la guerre froide, avec la volonté de transformer un héritage technologique à vocation militaire, profondément lié à la dissuasion nucléaire, en un levier commercial et économique », explique Béatrice Hainaut. Ainsi, le new space marque un tournant où la conquête spatiale n’est plus l’apanage exclusif des grandes agences gouvernementales, mais devient un secteur clé porté par l’initiative privée et les enjeux géopolitiques contemporains.
CONCILIER SOUVERAINETÉ NATIONALE ET DYNAMIQUE PRIVÉE
Face à ces bouleversements, la France mène une réflexion stratégique sur son avenir spatial. François Bayrou, Premier ministre, a confié l’élaboration de la stratégie spatiale nationale au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), une stratégie attendue pour juin 2025. Elle doit répondre aux enjeux de résilience et de sécurité dans un environnement international de plus en plus instable. « L’espace est à la fois un champ d’investigation scientifique incontournable et un environnement stratégique de premier ordre. Il influence directement notre sécurité et notre défense, tout en offrant de grandes opportunités économiques et industrielles », explique le Premier ministre.
La France se trouve à la croisée des chemins : concilier souveraineté et recours au secteur privé. Un compte rendu de l’Assemblée nationale de 2021 évoque un modèle en trois cercles pour structurer la stratégie spatiale militaire, un modèle qui peut également s’appliquer au secteur civil. Il distingue trois niveaux de souveraineté :
- Le cœur souverain : les capacités stratégiques, telles que les satellites de communication et d’observation, sont entièrement maîtrisées par l’État, garantissant leur disponibilité en toutes circonstances.
- Le cœur étendu : ce niveau regroupe les capacités fournies par des partenaires de confiance, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou de coopérations internationales.
- Le complément capacitaire : ce dernier cercle inclut les services civils et les partenariats stratégiques, utilisés en période de crise sans garantir un accès permanent.
Cet équilibre vise à préserver la souveraineté tout en tirant parti des opportunités offertes par les entreprises privées. Qu’il s’agisse de SpaceX ou d’autres acteurs du new space, aucune de ces entreprises n’aurait pu émerger sans un soutien massif des pouvoirs publics. Comme le souligne Béatrice Hainaut, « le plan France 2030 illustre bien cette logique, avec des investissements publics significatifs en faveur des start-up spatiales françaises ».
Cette délégation au privé, si elle favorise une montée en puissance rapide, n’est toutefois pas sans risque. « Aux États-Unis, certaines compétences pourraient se perdre au sein de la NASA ou d’autres agences », explique la chercheuse, et leur reconquête pourrait s’avérer difficile.
Dès lors, l’État doit clairement définir les domaines dans lesquels il accepte de dépendre d’acteurs privés, et ceux qu’il souhaite conserver en maîtrise souveraine. La prochaine stratégie spatiale nationale pourrait justement marquer de nouvelles orientations en ce sens.
UN ESPACE SANS RÉGULATION OÙ « LES TENSIONS GÉOPOLITIQUES TERRESTRES SE PROJETTENT »
Le droit spatial, encore jeune, peine à encadrer l’accélération des activités humaines dans l’orbite terrestre. Le Traité de l’espace de 1967, socle juridique de la gouvernance spatiale, établit des principes fondateurs : liberté d’accès, non-appropriation des corps célestes, usage pacifique. Il interdit l’installation d’armes nucléaires dans l’espace et proclame que les activités spatiales doivent bénéficier à l’ensemble de l’humanité.
Mais ce traité, adopté dans un contexte de rivalité bipolaire, montre aujourd’hui ses limites face aux enjeux du new space. Selon Béatrice Hainaut, « Les praticiens estiment généralement que ce traité est trop libéral, voire lacunaire. D’après certains juristes, ce serait à la jurisprudence de venir combler ses insuffisances. »
Faute d’accords contraignants, les États s’en remettent aujourd’hui à des normes de comportement pour encadrer les actions dans l’espace. Comme le souligne Béatrice Hainaut, « Certains États misent sur des normes de comportement responsable – une forme de soft law ». Elle ajoute que « ces normes sont parfois perçues ou jugées trop subjectives, en particulier par la Russie et la Chine, qui préfèrent renforcer le cadre contraignant – hard law – existant plutôt que d’adopter des codes de conduite. »
L’émergence du new space rend ces limites particulièrement préoccupantes. La multiplication des acteurs privés et l’encombrement croissant des orbites augmentent le risque d’incidents, sans qu’aucune autorité internationale n’assure une véritable régulation. Dans ce contexte : « les tensions géopolitiques terrestres se projettent désormais dans l’espace, rendant toute coopération plus difficile », résume Béatrice Hainaut.
Les pays émergents, quant à eux, plaident pour un encadrement plus équitable et inclusif. Ils appellent à la mise en place de normes de comportement responsables, dans l’espoir de garantir un accès juste aux ressources orbitales et de limiter les risques de conflits futurs. Mais sans volonté commune des grandes puissances, la gouvernance spatiale reste suspendue à un équilibre précaire.
LE DOUBLE DÉFI DE L’EUROPE : SOUVERAINETÉ ET COMPETITIVITÉ SPATIALE
L’Europe fait face à un double défi : maintenir sa compétitivité dans le secteur spatial tout en répondant à ses besoins de souveraineté. Bien que l’Europe dispose d’atouts considérables — avec des entreprises performantes comme ArianeGroup pour les lanceurs ou Airbus Defence and Space pour les satellites, elle peine à rivaliser avec les États-Unis. Selon Béatrice Hainaut ces derniers « ont l’avantage de pouvoir s’appuyer sur un marché intérieur dynamique, avec des besoins suffisants pour soutenir la compétitivité de leurs acteurs spatiaux ».
Le secteur des lanceurs européens est en pleine mutation, avec le développement parallèle de micro-lanceurs et de nouvelles initiatives comme Ariane 6. Dans ce contexte, des projets comme IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) représentent une opportunité majeure pour l’Europe. Lancé en mai 2023, ce projet vise à fournir une nouvelle infrastructure de communication sécurisée et résiliente, principalement pour les gouvernements et entreprises européennes. Le consortium formé pour développer cette constellation de satellites inclut des acteurs majeurs du secteur comme Airbus, Eutelsat et Thales Alenia Space. L’objectif est de mettre en place un réseau opérationnel d’ici 2027.
Le projet IRIS² pourrait marquer un tournant en matière de souveraineté spatiale européenne, permettant à l’Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de contrôler ses infrastructures de communication stratégiques.
« Il est crucial que l’Europe maintienne son leadership dans le secteur spatial, pour son autonomie et sa souveraineté », souligne Philippe Baptiste, président du Centre national d’études spatiales. L’innovation et l’investissement dans ce secteur seront des leviers déterminants pour garantir un avenir européen dans un espace devenu un enjeu géopolitique majeur.
Pour en savoir plus :
Source : IHEDN

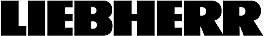







Be the first to comment on "« New space » : les défis stratégiques"